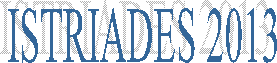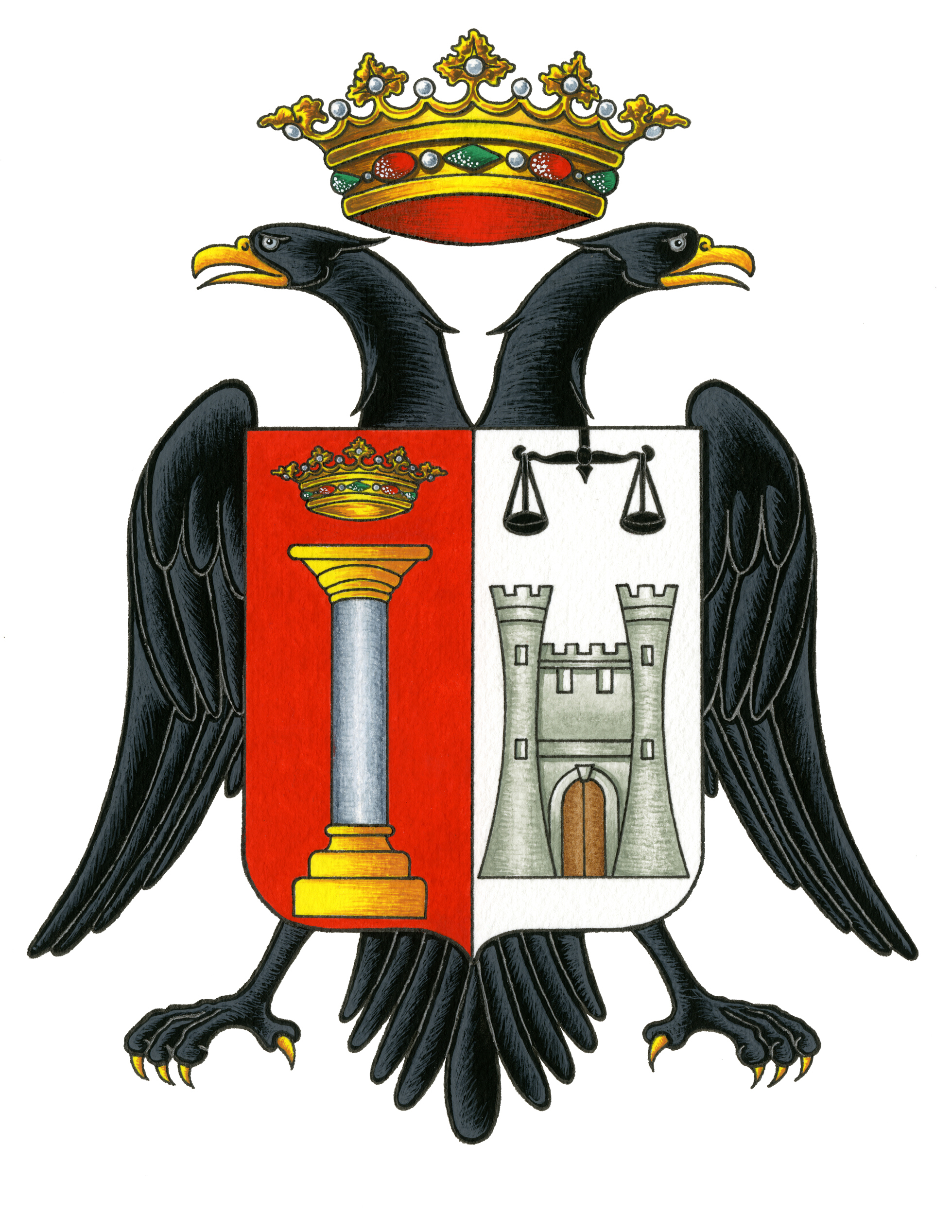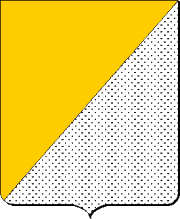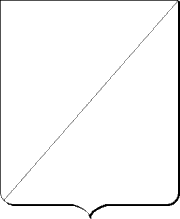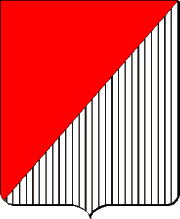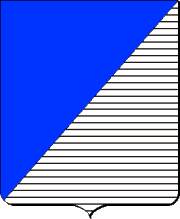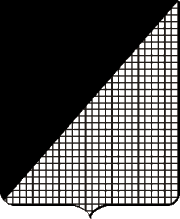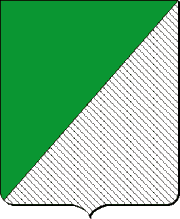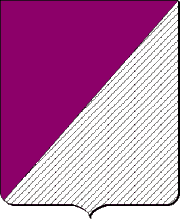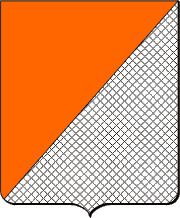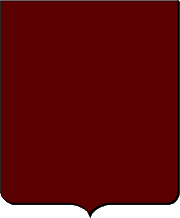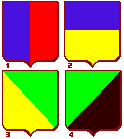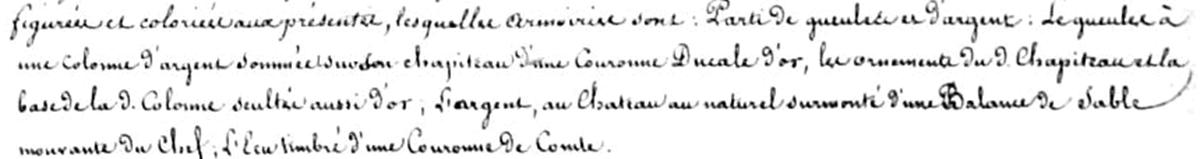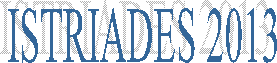
L'héraldique
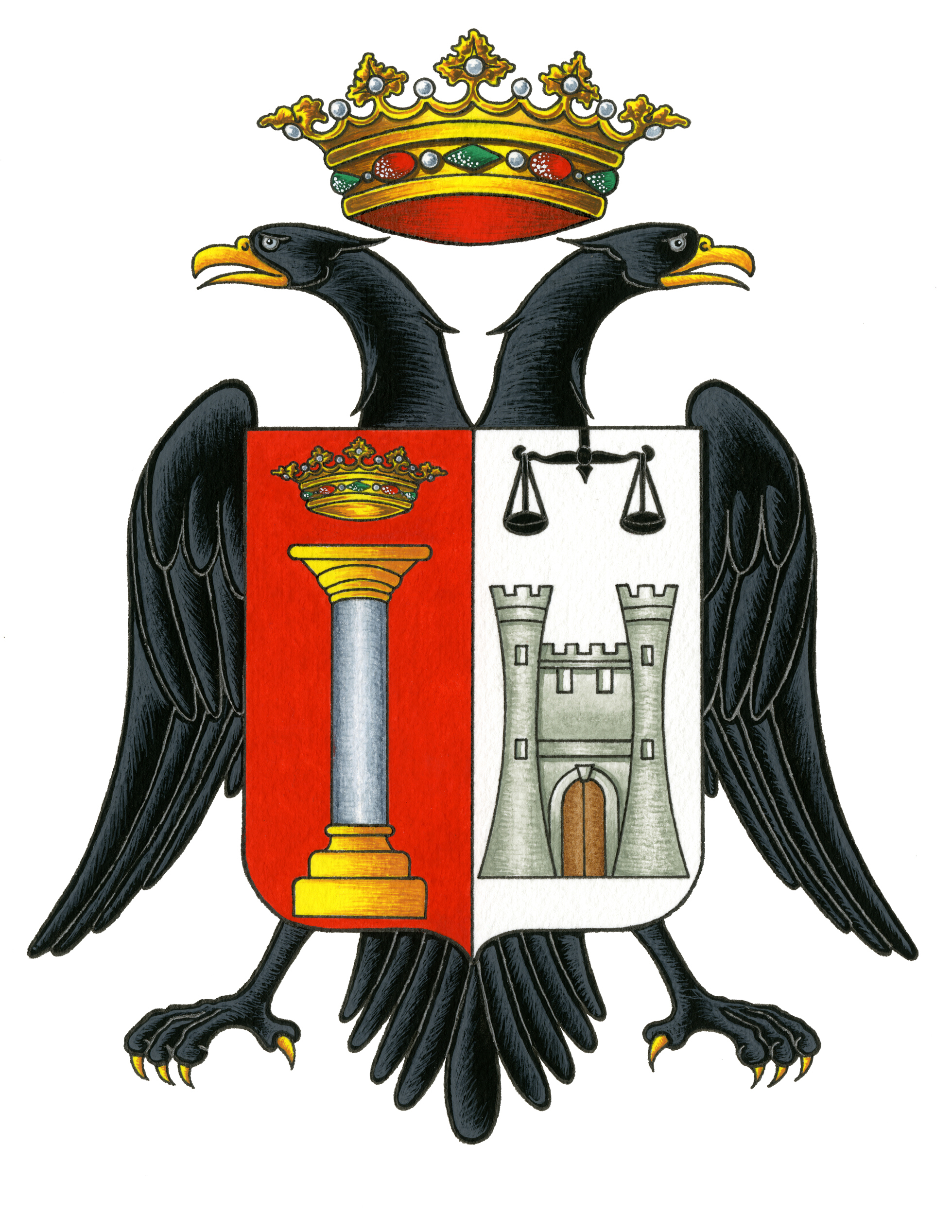
Le site
que j'ai le plaisir de gérer est doté d'un outil de mesure
d'audience. Ce logiciel permet un compte-rendu journalier de l'activité de la veille, à
savoir, le nombre de visites ainsi que le nombre de pages ouvertes, en France
comme à l'étranger. Pour chacun des pays l'indication géographique se limite
aux seules régions, PACA, Poitou-Charentes, Alsace, Washington, Québec, etc.
sans plus de détails et sans possibilité de relier les pages ouvertes avec un
pays ou une région, ce, pour la formule que j'ai choisie, c'est-à-dire la
version gratuite.
Il ressort
de ces statistiques, l'intérêt marqué pour tel ou tel sujet. Ainsi, j'ai pu
noter une forte curiosité pour les pages consacrées à l'héraldique et à la
noblesse. Je dis "Je", parce que je suis seul à disposer d'un droit
d'accès aux coulisses du site. Il va de soi
que la porte est ouverte à qui voudrait s'y intéresser.
De ces deux
thèmes, l'héraldique et la noblesse, nous retiendrons le premier pour
cette journée.
L'autre, la noblesse, pouvant être traité, a proxima volta.
Nous aurions souhaité
l'intervention éclairée de Monsieur Laurent Granier, héraldiste et
peintre-héraldiste, auteur de cette peinture qui a servi de matrice à l'atelier
de broderie. Malheureusement, tributaire d'un agenda
très chargé, celui-ci a dû décliner notre invitation.
C'est pourquoi
je me propose, bien modestement, d'ouvrir non un débat, du moins vouloir
expliquer ce qu'est l'héraldique.
En préalable,
il convient de lever une imprécision de vocabulaire s'agissant des termes
suivants :
Le terme « blason,
blasons » tel qu’il est utilisé par le grand public
est une impropriété, due à une confusion puisque dans le vocabulaire
héraldique, il désigne la description des armoiries
traduite en mots. Le blason ne désigne pas l’écu ou les
armoiries.
Le blason est la langue des armoiries, elle possède
un lexique (issue du Français médiéval) et une syntaxe
qui lui sont propres. C’est la seule langue au monde qui
décrive des images avec fidélité. Le blason permet de
fixer par écrit un dessin ou de le transmettre sans
avoir recours à l’image.
Les termes « armoiries » ou « armes » (toujours au
pluriel) sont donc à utiliser pour désigner soit le
contenu d’un écu, soit l’écu et ses ornements extérieurs
(heaume, tortil, couronne, cimier, lambrequins, devise,
cri, supports, tenants ou soutiens, bannières, ordre de
chevalerie…).
On ne porte pas un blason, on porte des armoiries. C'est ainsi !
Je n'y suis strictement pour rien.
Un peu de droit ou qu'en est-il de la loi ?
Ceci en quatre points :
-
L'usurpation d’armoiries /
Les armoiries homonymes
-
Armoiries et lignée
-
Usurpation de titres et de couronnes nobiliaires
-
Enregistrements d’armoiries, protection de ses armes
1- L'usurpation d'armoiries et armoiries homonymes
Bien que que nous soyons en République, la loi française
considère en effet les armoiries comme un accessoire inaliénable du patronyme,
qu’il soit noble ou non. L’honnêteté invite fortement de ne pas utiliser des
armoiries qui ne nous appartiennent pas. User indûment des armoiries d’autrui
peut coûter, très cher…
Il faut savoir que tous, individu ou
personne morale, administration, collectivités etc. avons droit à des armoiries. Cela n'a jamais été un privilège de
la noblesse, de même qu'elles n'induisent pas une quelconque appartenance à cet
ordre.
Les armoiries sont un bien propre attaché à un nom.
2 -Armoiries et lignée
Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, les armes sont attachées à une
lignée familiale et pas au seul nom patronymique.
Plusieurs familles homonymes dont le berceau est le même
espace géographique n’ont pas forcément de liens de
sang. Donc, toutes ne posséderont pas d’armoiries. Dans
ce cas de figure, la seule solution pour savoir si une
famille possède bien des armoiries -armoiries
existantes- est de constituer une
généalogie ascendante .
Je pense que pour nous, la preuve est
faite.
3 -Usurpation de titres et de couronnes nobiliaires
Il est absolument
contraire à l’éthique
d’ajouter une couronne de rang nobiliaire à des
armoiries non-nobles. Un particulier ne peut utiliser
une couronne nobiliaire pour timbrer ses armes sans être
en mesure de prouver une filiation directe attachée au
titre héréditaire correspondant.
Sachons par ailleurs qu’en France, aucun titre de
noblesse ne peut être légalement vendu ou acheté, le
titre de noblesse étant également considéré par la loi
comme un accessoire indissoluble du patronyme.
L’Association d’entraide de la Noblesse Française (A.N.F.)
et son équivalent dans différents pays européens veille
aussi à ce que ce genre de délits soit connu et puni.
À cet égard, nous sommes
reconnus par l'A.N.F. Si je ne me trompe, la démarche en
reconnaissance a été effectuée par Jean.
4 -Enregistrements d’armoiries, protection de ses armes
Il n’y a jamais eu en
France de véritable enregistrement de l’ensemble des
armoiries comme cela s’est toujours fait, par exemple,
en Angleterre.
L’État français n’enregistre pas les armoiries des
citoyens. Aucun organisme officiel en France n’est
habilité à le faire puisqu’il n’existe aucune autorité
héraldique française.
Il n’y a
donc que trois solutions pour protéger ses
armoiries d’une éventuelle usurpation selon le principe
juridique de la date certaine :
-
L’acte sous seing
privé : le moyen le plus simple et le moins cher de
faire date certaine est de s’adresser un courrier
recommandé avec avis de réception et de ne pas
l’ouvrir. Ce courrier doit comprendre le
blasonnement des armes ainsi qu’une copie de leur
représentation et, bien sûr, l’identité complète du
propriétaire. En cas d’usurpation des armoiries
par un tiers, il suffira de faire ouvrir ce courrier
par le tribunal compétent.
En France, les armoiries
dites "historiques," par exemple, déjà existantes sous
l’Ancien Régime, (ce qui est notre cas) relèvent du droit coutumier selon
lequel l’usage vaut propriété.
Venons en aux origines
de l'héraldique
L'héraldique est la science du blason, c'est-à-dire l'étude des armoiries. Elle
plonge ses racines dans le système féodal du Moyen Âge. Elle n'a pu s'épanouir
qu'à partir du moment où des expériences militaires, telles que, et
particulièrement, les Croisades,
ont rendu vraiment indispensable l'identification, rapide et sans équivoque, du
combattant et de la nation à laquelle il appartenait. Porter la marque
distinctive d'une nation était une nécessité pour ceux qui, après avoir quitté
leur patrie, se heurtaient à l'étranger à un obstacle linguistique que seuls les
lettré pouvaient franchir, grâce au latin.
À une
époque où la force primait sur le droit, ou plutôt était le droit, le principal
devoir du vassal consistait à être toujours prêt à accompagner son suzerain dans
les poursuites guerrières de ses objectifs et à le soutenir en personne. Aussi
longtemps que ces entreprises n'ont concerné que des poignées d'hommes armés, il
n'était pas nécessaire de les distinguer de façon systématique. On savait
toujours à qui l'on avait affaire. Il en fut tout autrement lorsque la première
croisade contraignit les Européens à mener à bien une vaste entreprise guerrière
en commun avec leurs voisins, tout en maintenant leur cohésion entre
compatriotes.
Un premier
moyen très simple de se reconnaître consiste à porter des marques de couleur à
des endroits convenables de l'équipement. Le procédé est fondamental : on
l'utilise encore, sur les chars d'assaut et sur les hommes. En 1968 une simple
bande blanche a suffit à distinguer des tanks identiques de l'armée tchèque, les
chars soviétiques intervenant en Tchécoslovaquie : les envahisseurs ne pouvaient
tirer que sur les engins démunis de la bande blanche. Ce fut tout aussi
simpliste vers 1100. Un certain sentiments national s'exprima, puis se
renforça, par le choix de couleurs distinctives pour les contingents nationaux
des croisés. D'autre part, l'évolution de l'armement, et de l'armure en
particulier, rendait l'homme méconnaissable sous son heaume fermé. Il fut dès
lors indispensable de porter des insignes aisément identifiables sur son armure,
à l'instar du tankiste sur son char d'assaut. Ces insignes consistaient en un
objet approprié fixé au casque, en marques distinctives de couleurs appliquées
sur des pièces d'armure, spécialement le bouclier. Par ailleurs on a tenu compte
du climat du pays qui imposait plutôt le col ouvert et le short, plutôt que la
carapace de cuir et d'acier ! Le chevalier franc a dû se protéger du soleil par
un couvre-nuque, vous verrez son importance.
Ainsi se
sont trouvés réunis les trois éléments constitutifs de toutes armoiries : l'écu,
le casque ou heaume et le volet (couvre-nuque) qui
donnera naissance au lambrequin. Le développement des armoiries restera
toujours tributaire, en ordre principal, de celui de l'art militaire.
En raison
du lien personnel existant entre le suzerain et son vassal, on a considéré, dans
les premiers temps, que les armoiries représentaient une personne plutôt qu'une
famille. Le jeune écuyer n'entrait pas dans la vie active aux côtés de son
père, mais bien aux côtés de son parrain de chevalerie. Cependant, le fait que
le vassal parvint peu à peu à rendre son fief héréditaire influença les
armoiries, qui devinrent de plus en plus des symboles juridiques : devenant plus
stables, elles devinrent héréditaires dans les familles et permanentes pour les
institutions ou les offices.
Je
reprends, en partie, cette dernière phrase : "Cependant, le fait que le vassal
parvint peu à peu à rendre son fief héréditaire." Dans la société médiévale,
basée sur l'économie rurale et sur la possession de la terre, il existait deux
types de propriétés foncières : l'alleu, impliquant la propriété
héréditaire intégrale du sol, et le fief, possession du souverain
concédée à un vassal pour qu'il puisse y trouver ses moyens de subsistance et
remplir ainsi son devoir de service. La tendance du vassal fut naturellement
d'assurer le bénéfice de son fief à ses descendants, ce qui conduisit à rendre
le fief héréditaire.
À cet
égard retenons que la Corse et a fortiori l'ISTRIA était un fief, son souverain,
le Pape. Nos ancêtres étaient ainsi dénommés : feudataires d'Istria.
Oserais-je une opinion ? Je ne crois pas que dans l'esprit de nos aïeux, comme
dans les faits, la frontière entre l'alleu et le fief, ait été jamais définie.
Feudataire sur le papier, mais propriétaire héréditaire de sang. En fait
l'utilisation du vocable feudataire par Gênes et consort, déniait juridiquement
aux Istria le droit de propriété des terres.
Dès le XIIe
siècle, les armoiries ont été soumises à des règles, toujours valables et
pratiquement inchangées depuis qu'elles ont été formulées et consignées avec
précision par des spécialistes de profession : les hérauts d'armes.
Les règles
développées par ces hérauts sont basées sur les usages de la guerre médiévale ;
la considération dont elles ont joui découle de l'importance des activités
militaires à cette époque. À la guerre ou au tournoi, chacun devait être
identifié le plus vite possible et sans erreur.
De cette
nécessité découle la règle fondamentale, dite de la contrariété des émaux, selon
laquelle on ne peut mettre métal sur métal, ni couleur sur couleur.
Les métaux
sont au nombre de deux, soit l'or et l'argent pour lesquels la représentation
picturale est le jaune pour l'or et le blanc ou neutre pour l'argent.
Bien que la couleur soit une caractéristique très importante,
elle n'est pas apparente quand les armoiries figurent sur des sceaux, des
monnaies, voire des sculptures sur des édifices ou des meubles. Ces armoiries
sont non peintes, ou la peinture en a été effacée.
Pour cette représentation monochrome des armoiries les couleurs
sont, dans ce cas, représentées par des hachures conventionnelles.
|
Or |
Argent |
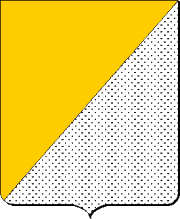 |
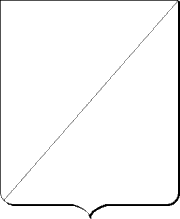 |
Dans tout
écu, il y aura dès lors une part appréciable d'or ou d'argent.
Les émaux
sont au nombre de 7
Le nombre
croissant d'armoiries ainsi que la diversité ou la richesse des mtifs ont
conduit à une autre
règle, fondamentale, la partition de l'écu : On appelle
partition la division régulière en plusieurs zones géométriques d’un
champ, d’une
charge ou d’un
élément d’une partition précédente.
Les quatre partitions de base sont :
·
1. le parti, c'est celui qui nous concerne
·
2. le coupé
·
3. le tranché (G/D)
·
4. le taillé (D/G)
L'écu non partagé, se dit plein
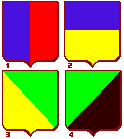
Charge :
pièce sur laquelle une autre est posée. C'est le cas des armoiries de Paolo
Vincenzo, marquis de Galliano qui hérite et reprend le marquisat de son oncle
maternel, et charge à cœur les armoiries Colonna d'Istria.
S'agissant
de nos armoiries, elles sont réglées ainsi :
Parti
de gueules et d'argent
Au 1 qui
est Colonna.
De
gueules à une colonne sculptée d’argent,
sommée sur son chapiteau d’une couronne ducale d’or, les
ornements, le chapiteau et la base de la colonne sculptée aussi
d’or.
Au 2
qui est Istria. D’argent
au château
naturel surmonté d’une balance de
sable
mouvante du
chef.
À ma
connaissance, il n'y a jamais eu de dépôt de règlement d'armoiries à l'exclusion
de celui figurant sur l'acte de recognition de noblesse d'Ignace Alexandre au
XIXe siècle, où il est précisé : l'écu timbré d'une couronne comtale.
Rappelons qu'Ignace Alexandre est fait comte par
lettre patente du 24 juillet 1825, sans attribution de lieu, c'est-à-dire 55
après qu'Ottavio fut
réintégré dans la possession du titre de COMTE de Cinarca.
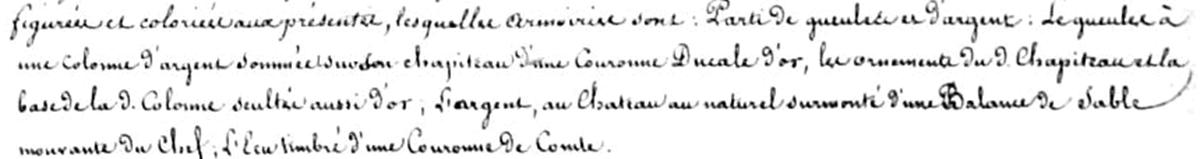
Ce qui
montre que les armoiries ne sont pas figées mais vivantes.
C'est
Ignace Alexandre qui dépose le 15 octobre 1825, le règlement des armoiries portées avant lui par
Ottavio, en distinguant son rameau par la marque de la couronne comtale et non
ducale. IL est fait comte, sans appartenance de lieu, contrairement à Ottavio
qui est comte de Cinarca. Rappelons que ce rameau, celui d'Ignace, n'est pas répertorié dans l'acte de recognition
de noblesse du 20 décembre 1773. La raison tient, selon notre regretté parent
Camille du rameau Joseph-Antoine 15, de ce que Francesco Maria, le trisaïeul
d'Ignace Alexandre aurait été absent de Corse au moment du rattachement de la
Corse à la France.
Pour autant,
l'édition de "Origine e Discendenza della Famiglia Colonna d'Istria,"
déposé par Ottavio à la Bibliothèque Royale en 1777, estampillée aujourd'hui
Bibliothèque de l'Arsenal, vaut dépôt légal de nos armoiries.
À tous égards, je
possède une photocopie de cet exemplaire, que j'ai obtenue de la BNF, moyennant
argent sonnant et trébuchant. Donc, si quelque doute demeuraient sur la validité
de nos attributs, la BNF pourra faire force de loi.
Je
voudrais lever une autre confusion, l'acte de recognition de noblesse du 20
décembre 1773, -Napoléon ne perçait pas encore sous Bonaparte - précise : "de noblesse prouvée au-delà de 200 ans. Pour les forts
en thème 1773 - 200 donne 1573 et au-delà suivant l'acte. La proclamation de
Napoléon empereur des français date du 18 mai 1804, son couronnement du 2
décembre de la même année. Rien à voir pour ce qui nous concerne avec la
noblesse d'empire, rien à voir avec l'aigle napoléonienne (monocéphale.) Nous sommes, pour
reprendre le mot de Michel Marie d'Ornano, de noblesse immémoriale en opposition
à la sémantique de la race, encore que la tendance actuelle de supprimer le mot race, me
conduit à une sérieuse réflexion. Le général de Gaulle dans sons discours
du 8 octobre 1943 à Ajaccio, à la Libération, ne parle-t-il pas de race s'agissant de la Corse et
des corses ? Nous tenons notre noblesse non pas de la faveur d'un quelconque
gouvernant du moment, mais de nous-mêmes et du peuple. De même que le titre de
comte porté par Octave, puisqu'Ottavio a été rétabli dans ses titres. J'en termine, nous sommes aux yeux de la République, non
pas "noble" mais "d'ascendance noble." C'est ce que pour ma part je revendique.
Revenons à
nos moutons, l'héraldique :
nous
devons au cardinal Asciano Colonna en 1597 la
confirmation de notre parenté commune et le droit de porter leurs nom et armes,
je cite : "...Quant à notre nom de famille et au blason de notre race, colonne
d’argent peinte sur champs de gueules, ornée d’une base et d’un chapiteau en or,
surmontée d’une couronne d’or, nous vous en faisons part volontiers... "
(Il faudrait ici reprendre le texte en latin et vérifier que le traduction est
bien "blason").
Si
l'héraldique a ses règles, elle a, tout naturellement, son vocabulaire. Ainsi,
Au 1. De
gueules à la colonne d’argent,
sommée sur son chapiteau d’une couronne ducale d’or, les
ornements, le chapiteau et la base sculptée de la colonne aussi
d’or.
Commençons
par le mot Gueules. L'étymologie
du mot gueules est incertaine, peut-être persane, romaine ou puisée dans le langage des
teinturiers.
Pour ce
qui est du 2, d’argent
au château naturel surmonté d’une balance de
sable
mouvante du
chef,
argent
: Couleur blanche. Pas de marque sigillaire.
naturel :
Dans ce
règlement la règle est couleur pierre, uni.
sable
: Noir. Quadrillage.
mouvante : "sortant d'un trait de
partition, d'un bord de l'écu." C'est le hasard qui réunit la balance
avec le terme "mouvante", n'importe quel attribut dans cette configuration
serait dit "mouvant/e." Dans les représentations les plus anciennes, maison de
Federico d'Istria à Sollacaro ou au fronton de l'abbadia dans la plaine de
Sollacaro, la balance est bien "sortant d'un bord de l'écu.
Du chef
: le chef est le tiers supérieur de l'écu.
Voici
démystifiées, du moins je l'espère, nos armoiries.
Les
ornements extérieurs
Ce sont les
tenants, supports et soutiens, c'est-à-dire tout ce qui figure
hors de l'écu. Ils n'ont pas la même valeur ou n'en ont carrément pas. Avec le
temps, les armoiries, ont dépassé leur seule utilité militaire : l'art s'en
empara aussitôt qu'elles devinrent des insignes purement graphiques. Au XIIe
siècle, les artistes pouvaient s'inspirer de la réalité. Le chevalier portant
lui-même son écu ou l'écuyer chargé de l'équipement de son maître fournissaient
des modèles quotidiens de tenants, dont la somptuosité devait être
reproduite inévitablement dans l'art. On donne le nom de tenants aux
personnages humains (hommes sauvages, chevaliers, anges, saints) qui tiennent
l'écu. C’est ainsi que les plus anciennes armoiries connues, celles de Geoffroy
Plantagenêt à la cathédrale du mans, ont été effectivement par leur titulaire et
ont été reproduites en couleur sur la lame funéraire émaillée (Feuille
de métal, longue et peu épaisse, toujours rigide, fermant une plate-tombe. Elle
peut être émaillée, peinte ou gravée et comporter une épitaphe.
Note applicative : Ne pas confondre
la lame funéraire avec la plaque funéraire. La lame funéraire peut avoir été
extraite de la plate-tombe (dalle) et placée
verticalement contre un mur.)
Toute représentation d’un seigneur avec son écu constitue en fait un modèle de
tenant héraldique. On réserve le nom de supports aux animaux, réels ou
fabuleux qui "supportent l'écu. Enfin, s'il s'agit d'objets inanimés tels que
colonnes, arbres, etc., on parle de soutien. Pour celles et ceux qui
possèdent l'ouvrage d'Ottavio, ils n'auront qu'à s'y reporter. Tous ces symboles
sont représentés sur l'eau-forte.
Nous nous
arrêterons, en premier lieu, sur le support, pour le cas l'aigle qui porte
l'écu. Cette aigle, bicéphale, m'a passablement ennuyé. En toute logique,
Ottavio aurait dû représenter une aigle -en héraldique aigle et du genre
féminin- aux ailes éployées qui est l'aigle du Saint empire romain germanique.
L'héraldiste que j'ai consulté m'engageait vivement à cette modification. Je
n'ai pu m'y résoudre. Pour deux raisons. L'une tient au manque de temps pour me
livrer à une consultation auprès de chacun des souscripteurs, l'autre ma gêne de
"trahir" Ottavio. Les pattes ont été allongées pour donner une impression de plus
de force.
Je n'ai
pas eu d'hésitation à l'égard du heaume ainsi que du positionnement de la
couronne.
Le heaume
n'est jamais représenté sans ses lambrequins (lambeaux d'étoffe stylisés
attachés au heaume.) Je rappelle que le lambrequin est l'héritier du
couvre-nuque. Il fallait soit créer ces lambrequins, déborder et surcharger les
cous de l'aigle, soit le supprimer. J'ai jugé flagrante la faute du conseil
d'Ottavio et supprimé le heaume. S'agissant de la couronne ducale, dans le même
soucis d'esthétique, elle est toujours
détachée. J'ai suivi l'avis de l'héraldiste et les ai séparés l'un de l'autre.
Nous ignorons si le conseil d'Ottavio était français ou italien.
L'écu :
nous avons harmonisé le rapport entre le support, l'aigle, et l'écu, en
réduisant les dimensions de ce dernier.
Par
essence, les armoiries ne sont pas figées dans le temps. Je pense les avoir un
peu dépoussiérées.